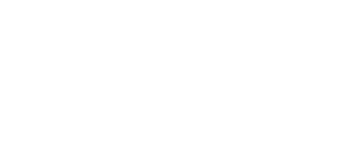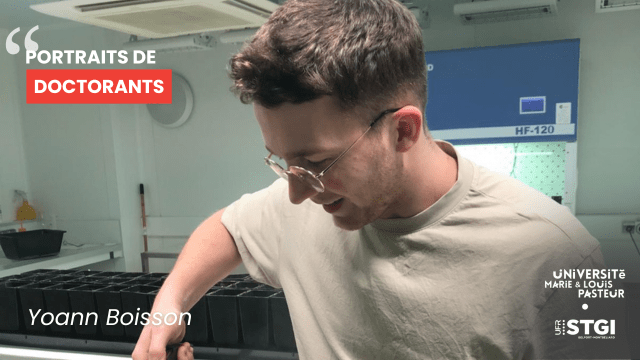Portrait de Doctorants : Yoann Boisson, une thèse pour remédier à la contamination des sols grâce à des solutions écoresponsables de phytomanagement
Yoann Boisson a débuté son parcours en Sciences de la Vie et de l’Environnement à l’UFR STGI. Aujourd’hui doctorant au laboratoire Chrono-Environnement, il consacre ses recherches à la contamination des sols par les éléments traces, avec pour objectif de développer des solutions écoresponsables. Passionné par l’expérimentation et soucieux d’agir pour le bien de notre planète, il partage avec nous son parcours, ses travaux et sa vision de l’avenir.
Bonjour Yoann, tout d’abord pouvez-vous vous présenter ?
Je m’appelle Yoann Boisson, je suis originaire de Belfort et j’effectue mon doctorat au sein du laboratoire Chrono-Environnement à Montbéliard, unité mixte de recherche rattachée à l’Université Marie et Louis Pasteur (UMLP) et sous tutelle du CNRS. J’ai débuté mon parcours universitaire par une première année de Licence Sciences de la Vie à Strasbourg puis j’ai rejoint l’UFR STGI pour intégrer la Licence Sciences de la Vie et de l’Environnement. Je suis ensuite allé à l’Université Claude Bernard à Lyon, où j’ai obtenu une licence professionnelle en Maîtrise des pollutions et des nuisances.
Concrètement, comment s’organise votre semaine de doctorant au sein du laboratoire ?
Je travaille à plein temps au laboratoire à Montbéliard, et je réalise 64h d’enseignement par an, ce qui correspond au maximum autorisé pour un doctorant. Mon contrat a été signé sous UBFC mais je suis rattaché à l’UMLP. Je me déplace régulièrement sur le terrain, notamment à Carrières-sous-Poissy et à Vieux-Charmont, et je mène aussi des expérimentations au laboratoire Chrono-Environnement à Besançon. J’ai également l’occasion de participer à des colloques scientifiques en Europe, en lien avec la pollution des sols ou dans le cadre de mon projet.
Ma thèse est entièrement financée par l’Union européenne, via le projet EDAPHOS.
Quelles ont été les étapes, depuis le début de votre contrat de doctorant ?
Au début de mon doctorat, en octobre, je me suis déplacé en Grèce dans le cadre d’activités du projet EDAPHOS, incluant l’acquisition d’images multispectrales par drone et une assemblée générale du projet. En novembre, j’ai assuré 64h d’enseignement (en L1, "Organisation du monde vivant - Biologie végétale" ; en L2, "Physiologie végétale" ; en L3/M1, "Biostatistiques multivariées") tout en menant une expérimentation sur deux espèces herbacées afin d’évaluer leur capacité d’adaptation sur deux sols contaminés.
En ce début d’année 2025, j’ai collaboré avec plusieurs projets européens (BIOSYSMO, PHIBY, DARK & STRONG) en mettant en place des expériences en conditions contrôlées, notamment sur l’effet de deux consortiums de champignons sur la croissance et l’accumulation d’éléments traces chez le peuplier.
J’ai également lancé l’expérience principale de mon projet, en plantant 384 peupliers à Carrières-sous-Poissy et 384 à Vieux-Charmont. À l’avenir, je prévois d’explorer des techniques de spectrométrie en phase gazeuse pour mesurer l’impact de certains traitements sur les plantes, ainsi que des techniques de séquençage d’ARN pour quantifier l’expression de certains gènes clefs et ainsi évaluer plus finement les effets de mes traitements.
Parlons de votre sujet de thèse, comment s’intitule-t-elle et en quoi consiste-t-elle ?
Ma thèse s’intitule « Développement d'un système de cocultures amendé pour le phytomanagement de sites contaminés aux éléments traces ». Elle s’inscrit dans le cadre du projet européen EDAPHOS, qui vise à développer des solutions écoresponsables de phytomanagement pour remédier à la contamination des sols par les éléments traces (ET), un enjeu environnemental majeur en Europe.
Plus précisément, elle explore l’utilisation d’hybrides de peuplier, cultivés en coculture avec des plantes comme Brassica juncea ou Lablab purpureus, en association à l’inoculation microbienne et à l’ajout d’amendements dans le but d’optimiser à la fois la phytoextraction d’éléments traces et la production de biomasse.
Ces approches sont testées à la fois en conditions contrôlées (expérimentations en pot) et sur le terrain, afin d’en évaluer l’efficacité et la transférabilité en conditions réelles.
Dans cette thèse, quel est l’aspect qui vous anime le plus ?
Ce que je trouve le plus stimulant, c’est à la fois la recherche fondamentale et les nombreux déplacements sur le terrain. Me dire que je contribue, à mon échelle, à la protection de l’environnement est une vraie source de motivation.
Quels chemins envisagez-vous après votre doctorat ?
Après ma thèse, j’envisage un post-doctorat, de préférence en dehors de l’Europe de manière à continuer des recherches dans ma thématique pour pouvoir accéder à un poste de Maître de conférences, en France ou à l’étranger.
Un mot pour finir, quelque chose à aborder ?
Je suis fier de pouvoir mener ces travaux de recherche, d’accompagner les étudiants dans leur formation, et d’apporter ma pierre à l’édifice face aux enjeux environnementaux actuels.

Commentaires0
Veuillez vous connecter pour lire ou ajouter un commentaire
Articles suggérés